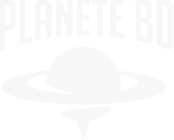Scénariste, dessinateur, membre fondateur de l’Association, David B. se glisse sous les projecteurs du 9e art en publiant, entre 1996 et 2003, L’Ascension du Haut Mal un récit autobiographique de 6 tomes, considéré par beaucoup comme un chef d’œuvre. Souvent estampillé auteur « nouvelle BD », en raison de son trait particulier et de son approche narrative, David B. aime surtout transmettre et raconter des histoires qui empruntent les chemins du rêve. Ses derniers albums Le Roi Rose, Journal d’Italie et Terre de feu, l’illustrent parfaitement…
interview Bande dessinée
David B
Bonjour David B ! Pour vous présenter auprès des lecteurs qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous raconter votre parcours, votre arrivée dans la bande dessinée et… pourquoi la bande dessinée ?
David B. : J’ai toujours aimé faire ça, depuis que je suis tout petit. Comme je le racontais dans un de mes albums, je voulais être soit peintre, soit dessinateur de bande dessinée. Et finalement, dessinateur de bande dessinée, c’était plus à ma portée. Puis j’adore raconter des histoires et dessiner. Donc la bande dessinée est venue tout à fait naturellement, puisque l’on dessine et que l’on raconte des histoires à travers les dessins.
Quand on évoque votre travail en bande dessinée, on accole souvent votre nom à la bande dessinée moderne. Est-ce que c’est quelque chose qui, pour vous, est représentatif ? Est-ce qu’il y a une « BD moderne » ? Qu’est-ce que la « BD moderne » ?
David B. : Oui, on a créé L’Association, avec des copains : Killofer, Stanislas Barthélémy, Mattt Konture, Jean-Christophe Menu et Lewis Trondheim. C’est vrai, c’est quelque chose qui a marqué la bande dessinée à son époque. Maintenant, le temps a passé, alors on me présente comme un dessinateur de la nouvelle vague, de la nouvelle génération… Ça me fait un peu rire ! Mais oui, c’est vrai que j’ai toujours eu le sentiment de travailler dans ce sens-là, de toute façon. De faire une bande dessinée particulière, qui n’est pas forcément une bande dessinée « grand public », qui n’emprunte pas les chemins attendus. C’est quelque chose de plus particulier, sans doute, de plus cérébral, de plus « intellectuel », ce que je fais. C’est mon approche de la bande dessinée en tout cas, quelque chose de plus proche de la littérature. C’est quelque chose qu’on a recherché aux débuts de L’Association. Après, oui, je crois qu’il y a une nouvelle génération, maintenant et que pour certaines personnes de cette « nouvelle génération », je suis une référence. Ça me fait bien plaisir, mais je ne peux plus dire que j’appartiens à la nouvelle génération !
Une autre caractéristique de votre travail c’est cet univers onirique que vous mettez en scène à chaque fois pour raconter les histoires souvent assez bluffantes, souvent proches de quelques sources d’hallucinogènes. Cela procède de quoi ?
David B. : C’est que j’ai toujours été fasciné par le rêve, qui est un peu pour moi la matière brute du fait de raconter les histoires. Quand je rêve, mon inconscient m’invente des histoires que je serais incapable d’inventer.
Cette nécessité d’avoir une approche onirique de narration apparaît donc comme une manière de raconter évidente.
David B. : Oui, pour moi c’est un peu « la racine » du récit si vous voulez. Cela m’intéresse toujours d’y revenir, c’est un peu une sorte de retour aux origines, du fait de raconter des histoires. C’est-à-dire que l’on est son premier spectateur pendant la nuit, son premier auditeur aussi d’une certaine façon.
En même temps cela permet de dire des choses très personnelles ?
David B. : Oui, bien sûr. Mais c’est aussi un réservoir d’images extraordinaire. Dans mes rêves, je trouve des images que j’ai tout de suite envie de dessiner. Quand je me réveille et que je me souviens de mon rêve, je vois tout de suite le dessin que ça peut faire. C’est fascinant de travailler comme ça, d’utiliser cette matière qui m’est offerte pendant la nuit, comme ça, qui vient toute seule.
Fin 2009, vous avez justement publié Le roi rose (chez Gallimard) et qui, en marge d’adapter un roman de Mac Orlan, est une ode à l’onirisme. Cette publication vous tient très à cœur ?
David B. : Oui, Pierre Mac Orlan est un auteur que j’ai découvert il y a très très longtemps. C’est un des premiers auteurs d’adultes que j’ai lus. Il m’a énormément frappé par son style, par une langue que je trouve très élaborée, très belle. J’ai toujours eu envie de l’adapter, mais il y a toujours le problème des droits. Puis quand Gallimard a créé cette collection d’adaptations de livres du fonds Gallimard, bien entendu on pouvait avoir accès à tous les livres comme celui-ci. Il suffisait que les ayant-droits soient d’accord et là, ils l’ont été. J’ai pu alors adapter cette nouvelle, que j’avais déjà proposée à Casterman il y a 20 ans à peu près. Mac Orlan est un auteur qui m’a toujours plu. C’est quelqu’un qui a inventé quelque chose qu’il définissait comme le « fantastique social ». Pour lui, le fantastique venait de cette vie tellement quotidienne, des fois tellement banale, tellement pauvre, que cela finissait par dégager du fantastique et que celui-ci naissait finalement de quelque chose de très naturel. C’est un élément qui me plaisait beaucoup, cet élément fantastique et onirique étant toujours très présents dans son travail, même s’il a écrit des romans très concrets, très terre-à-terre. J’aime beaucoup ses délires dans lesquels il est capable de partir à partir de moments, d’éléments, très concrets. Donc je me suis dit que c’était l’idéal pour cette collection d’adapter cette histoire.
Cette histoire en particulier ?
David B. : Oui, c’était vraiment cette histoire-là que je voulais adapter. Moi j’aime tout Mac Orlan, mais tout n’est pas forcément facile à adapter en bande dessinée. C’est-à-dire que le point de départ était clairement fantastique, puisque c’est l’histoire du « Hollandais Volant », c’est-à-dire celle de pirates qui cherchent la rédemption. Cela permet aussi d’avoir un plaisir à dessiner, c’est ça qui m’a déterminé à la faire.
Vous vous en êtes donné à cœur joie !
David B. : Oui, absolument ! Je me suis régalé à la dessiner ! Après il y a des histoires qui sont beaucoup plus en clair-obscur qui, à mon avis, me conviendraient moins. Là, il y avait une espèce de flamboiement, de délire, de choses comme ça qui me permettaient – dans ce travail d’adaptation – d’ajouter des choses personnelles, de les « pousser » un petit peu. Mac Orlan est quelqu’un de très elliptique, par exemple dans les scènes d’action, et justement cela me permettait de rejouer ces scènes d’action à ma manière.
Votre actualité se centre à présent autour de Journal d’Italie dans la collection « Shampooing » de Delcourt. Comment présenteriez-vous cet ouvrage et sa genèse ?
David B. : C’est venu de mon amour pour l’Italie, un pays que j’ai découvert quand j’étais petit. J’y suis allé en vacances avec mes parents. C’est un pays que j’ai retrouvé à travers la bande dessinée depuis quelques années, puisque j’ai rencontré des dessinateurs, des éditeurs italiens. De fait, je suis beaucoup allé là-bas. C’est un pays que j’ai redécouvert, effectivement. Je parle italien, du coup j’y ai rencontré une femme : tout ça crée forcément des liens ! Là-bas, j’ai eu envie de concrétiser une chose à laquelle je pensais vraiment : cette forme de « journal » que je voulais traiter en bande dessinée. Pas mal de gens font leurs journaux en ce moment et je me demandais comment je me frotterais, moi à cet exercice particulier. J’ai commencé les premières pages et je n’étais pas forcément convaincu de ce que j’étais en train de faire. J’ai montré ça à Lewis Trondheim, qui est directeur de la collection Shampooing, qui m’a dit « mais si, vas-y c’est super ! » et on est partis comme ça, en fait ! J’ai continué, j’ai fait le livre jusqu’au bout, voilà.
Donc la BD se construit autour d’un voyage, de vos observations, un petit peu comme le fait Lewis Trondheim avec ses Petits riens ?
David B. : Oui, pour plaisanter, justement, je lui disais que « Trondheim il fait des Petits riens alors que moi je fais des ‘grands tout’ ! » (sic). En fait, lui fait vraiment une page avec un petit événement dans sa journée, événement qui lui évoque quelque chose de sa réflexion sur le monde. Moi, j’utilise plus chaque jour pour raconter une petite histoire, une chose qui pourrait me prendre tout un album. Mais alors, je me permets de faire plus librement et plus rapidement des histoires, de les éditer plus vite, sans mettre en branle tout un long processus éditorial pour une histoire qui ne mérite pas forcément le cadre d’un album de 48 pages. Là, c’est plus rapide et j’ai un grand plaisir à dessiner comme ça. Ça m’a beaucoup plu. Enchaîner des histoires sur des sujets très différents me permettait de passer en revue toutes les thématiques que j’apprécie : le rêve aussi bien que le quotidien, des choses que je vais prendre dans les journaux, des faits divers qui m’ont intéressé… Cela me permet de parler de littérature, de parler de légendes, de parler d’histoire et surtout, de sauter du coq à l’âne, comme j’ai envie, d’un sujet à l’autre. C’est quelque chose de très libre et je n’avais jusqu’alors jamais envisagé le travail de cette façon-là. C’est en ça que c’est sans doute quelque chose de nouveau.
C’est comme un « défi » qui vous intéressait ?
David B. : Tout à fait, oui, sinon je ne l’aurais pas mené à bien !
Est-ce quelque chose susceptible d’être poursuivi sur le long-cours ?
David B. : Oui, ce sera au long-cours. De toute façon, je le ferai tant que j’aurai envie de le faire, tant que ça m’apprendra des choses. C’est un peu comme des notes qui sont prises sur mes sujets d’intérêt, sur ce que j’aime faire et c’est une manière de montrer à mes lecteurs comment je crée une histoire, comment je vais créer un scénario, comment je peux prendre des choses à droite et à gauche et un peu tout ce qui constitue mon univers. C’est comme montrer le processus de création d’une bande dessinée, la mécanique à l’intérieur du cerveau quand je suis là, en train de regarder autour de moi, de guetter une idée potentielle, comment elle germe et comment elle se transforme.
La manière de mettre en forme cette observation, vous ne la voyez pas autrement que par le canal de la bande dessinée ?
David B. : Non. Je ne me vois pas écrivain, parce que je ne sais pas si j’aurais du style pour ça. La littérature, c’est autre chose. De toute façon, j’ai envie de dessiner. Donc pour moi, le mieux, c’est de faire de la bande dessinée, bien évidemment. J’ai envie de dessiner et de raconter des histoires, pour moi la bande dessinée c’est un truc formidable ! Je ne peux pas rêver mieux !
Quels sont vos influences en bande dessinée ? Etes-vous un gros lecteur ?
David B. : Oui, je suis un gros lecteur. Je suis un assez gros lecteur en général : en bande dessinée et en autres choses. Donc je lis des tas de choses. J’ai beaucoup de copains italiens et donc en ce moment je lis beaucoup Gipi. Récemment, j’ai lu le dernier livre d’Alessandro Tota qui a paru chez Sarbacane, Terre d’accueil. C’est un livre que j’ai beaucoup aimé. Sinon j’ai été beaucoup influencé par Tardi, par Munoz, par Hugo Pratt, quand j’étais adolescent, essentiellement. Il y a Edward Gorey, aussi, dont j’avais saisi quelques histoires. Sinon, j’ai été très influencé par la littérature fantastique, le cinéma et encore des tas de choses. De toute façon c’est ce que j’essaie de monter dans ce Journal d’Italie, c’est que je prends tout ! Dedans je parle de littérature, de cinéma, de légendes, de paysages. Tout ce qui va faire le sel d’une petite histoire.
Si vous aviez la possibilité d’aller dans le crâne d’un auteur de bande dessinée pour voir un petit peu ce qui se passe, qui choisiriez-vous ?
David B. : En ce moment, je lis l’œuvre de Joe Sacco. Voilà : j’aimerais être dans la tête de Joe Sacco pendant qu’il fait son reportage pour voir comment ça se passe justement ; pour voir comment il fait sa bande dessinée, parce que je suis bluffé par son travail et la justesse de son dessin. Il n’a pas du tout un dessin réaliste, pas un dessin forcément séduisant, mais ses dessins sont très équilibrés, très construits. Donc j’imagine qu’il travaille d’après photo. Il interviewe les gens et j’aimerais assister à ça, voir à travers ses yeux et entendre à travers ses oreilles pour savoir comment ça se passe pour me dire « Ah oui ! C’est comme ça que ça passe sur la page, c’est comme ça qu’il le traite ! ».
Si vous n’aviez pas fait de la BD, qu’auriez-vous fait ?
David B. : Comme le disait ma sœur dans la préface de L’Ascension du Haut Mal, je crois que j’aurais été professeur d’histoire. De toute façon, j’aurais cherché à transmettre quelque chose à des gens. Pour moi, la bande dessinée c’est aussi ça, c’est ce que j’essaie de faire à travers ce Journal d’Italie : transmettre des informations. Etant passionné d’histoire, j’aurais sans doute été professeur d’Histoire ou d’Histoire des religions. Quelque chose qui touche à la fois à la croyance de l’Homme et à sa vie.
Merci David B !