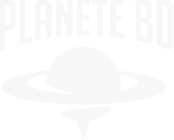En cette fin d’année 2008, Largo Winch est à l’honneur ! La sortie du dernier tome, La voie et la vertu, n’est cette fois pas seule à créer l’évènement : le film Largo Winch est sur nos écrans à partir du 17 décembre, et quel film ! Super production française, très fidèle à la série BD (il reprend la trame du 1er tome, L’héritier), cette adaptation ciné est promise à un beau succès. La preuve : les éditions Dupuis se sont d’ores et déjà engagées pour un second volet ! Nous en avons bavardé avec l’un des deux papas de cette série mythique, le dessinateur Philippe Francq, lors d’un déjeuner des plus agréables…
interview Bande dessinée
Philippe Francq
Bonjour Philippe Francq. Nous nous rencontrons en pleine effervescence : rarement l’actualité winchienne aura été aussi chargée ?
Philippe Francq : On a effectivement 3 trucs qui sortent au même moment. Tout d’abord il y a l’album BD, le tome 16, c'est-à-dire le second tome du diptyque qui se déroule à Hong-Kong. Puis le 17 décembre 2008, sort l’adaptation en film sur les écrans de cinéma. Et enfin, un documentaire en DVD, avec 1h30 de bonus. L’équipe de reportage nous a suivi, Jean et moi, durant près de 24 mois.
Le film, c’est quelque chose que toi et Jean attendiez, ou espériez depuis longtemps ?
PF : On prend ça comme un joli cadeau. Ça fait 19 ans qu’on travaille sur cette série. Pour le public, ça ne fait que 18 ans, vu que les lecteurs prennent connaissance de notre travail avec un décalage d'1 an à chaque fois. On est très flattés car en général, le cinéma s’intéresse plutôt à des séries BD qui ont entre 35 et 45 ans d’existence. On a eu Michel Vaillant, Astérix, Blueberry…
Peut-on en conclure que Jean Van Hamme s’exporte pas mal au 7e art ? Il y a déjà eu l’adaptation de XIII qui est passée sur Canal + cet automne…
PF : Oui, mais Jean a toujours écrit pour le cinéma. Il a énormément écrit pour la télévision, des projets qui n’ont pas été retenus et il en a fait des bandes dessinées. L’ironie de l’histoire, c’est que ces mêmes télévisions qui, à l’époque, avaient refusé ses projets, se sont intéressées à ses séries BD avec le désir de les adapter à nouveau pour la télévision. On retient surtout Les maîtres de l’orge mais il y en a eu bien d’autres…
Quel effet ça fait de voir son bébé pris en main par une autre équipe d’artistes, dans un autre registre ?
PF : En premier lieu, je suis flatté : on fait ce métier pour que ça marche, pour être lu, pas pour être ignoré. Ça donne du courage pour la suite. Si je n’avais pas été lu, je pense que j’aurais abandonné le métier depuis longtemps. Et évidemment, le cinéma, c’est la cerise sur le gâteau. Le fait que ce soit pris en main par une autre équipe ne m’est pas dérangeant. Je ne me sens pas concerné par le travail sur un plateau de tournage. Ça demande énormément de compromis parce qu’il faut travailler en équipe. Moi, je travaille seul, dans un atelier, pendant 10 mois, certes en consultant mon scénariste de temps en temps, mais je reste le maître d’œuvre de ma création. En aucun cas je ne voudrais m’encombrer d’un autre dessinateur dans mon atelier, qui travaillerait par exemple sur les décors… Je ne supporterais pas de devoir déléguer des choses aussi intimes que cela. Intellectuellement, j’ai du mal à comprendre comment on peut morceler autant une vision d’une même œuvre qui est, par essence, intime à un maître d’œuvre. La seule solution, c’est de payer cher pour pouvoir s’entourer d’équipes très compétentes. C’est en tous cas une autre manière de travailler.
A aucun moment on vous a demandé de jeter un œil pour valider tal ou tel choix artistique ?
PF : On ne m’a pas demandé, ce qui ne m’a pas empêché de donner quand même mon avis. Mais de toutes façons, toutes les indications de mise en scène sont prescrites dans le bouquin. La BD parle d’elle-même, il n’y a pas besoin de long discours pour décrire la scène : finalement, la BD est le story-board. J’avais vu quelques photos de Tomer Sisley, et j’ai juste donné quelques conseils sur sa coiffure et la manière de l’habiller, des couleurs avec lesquelles il ne fallait pas le travestir. Mes conseils se sont limités à cela. Jean a été un peu plus présent en la matière. Entre la totalité des rushes et le film final, selon la manière de monter, on peut faire 30 films différents.
Que penses-tu du résultat du film, sans la langue de bois inhérente à la période de promo ?
PF : Sincèrement, je pense que c’est une belle réussite. D’abord, je ne me suis absolument pas ennuyé en regardant le film. Le rythme est maintenu tambour battant, les scènes d’action sont super bien filmées, ça part dans tous les sens, et surtout le film est très respectueux du scénario original du premier tome de la série. Cela raconte l’accession éclair d’un vaurien hirsute au sommet d’un monde qu’il ne connaît pas, et qui a du mal à se faire accepter par les présidents en place. C’est quand même bien la première fois que le cinéma s’intéresse à la bande dessinée en étant soucieux de ne pas s’écarter du scénario originel, de ne pas commencer à délirer… Il y a juste quelques petits chemins différents. Cela fait aussi l’intérêt du film : le lecteur qui connaît l’histoire par cœur sait d’emblée où le film va l’emmener et pourtant, dans la salle, il va conserver un suspens. Il sera aussi surpris qu’à la première lecture. Par ce qu’il y a quand même des coups de théâtre à la fin du film, qui sont différents de ce qu’on a dans la bande dessinée. C’était un risque à prendre, qui s’avère très efficace. Enfin, l’acteur, Tomer habite vraiment le personnage de Largo Winch. Pendant les 10 premières minutes, j’ai eu un doute, mais à la dixième minute, on oublie totalement que c’est un acteur et on suit Largo. Je pense que tous les lecteurs auront ce doute initial, et puis il y a un moment charnière où on se prend de sympathie, et c’est parti, ça ne nous lâche plus jusqu’à la fin du film.
Le film ne risque t-il pas de souffrir de la comparaison avec la série TV, qui n’est – excuse moi – franchement pas terrible… ?
PF : la série TV a un avantage, c’est qu’elle existe. On va dire que le pilote était prometteur… mais la suite a vraiment été décevante. Et ce, quand bien même les acteurs étaient bien castés : on avait des tronches qui ressemblaient très fortement aux miens dans la BD : Simon, Sullivan et même Largo… Ils sont moins ressemblants dans le film de Jérôme Salle, mais dans un film, je pense que ça n’est pas l’essentiel. Le plus important, c’est de respecter l’esprit de la BD, et ça c’est réussi. L’acteur de la série TV avait un sourire un peu bête. Alors que Tomer Sisley, quand il sourit, on retrouve la malice et l’intelligence de Largo. Je le compare un peu au sourire de Sean Connery… Le Largo qui n’est en fait jamais étonné de rien, que j’essaie de faire transparaître dans la BD, Tomer le joue à merveille ! Et en plus il bouge comme un félin, comme j’espère que le lecteur se l’imagine bouger à travers ses épisodes BD. C’était un défi pour Tomer, et je pense qu’il a réussi son coup.
Tu as donc vu le film, tu l’as aimé, mais ne serais tu pas inconsciemment influencé, parce que tu aimes forcément ce personnage qui t’accompagne depuis près de 20 ans ?
PF : Je suis effectivement curieux de constater l’avis du public. Je ne sais pas si mon avis positif sera aussi celui du lecteur fan ou celui du néophyte. Mais je ne me sens pas trahi et c’est déjà énorme d’avoir réussi ça.
Au début de ta carrière, tu t’y attendais de devoir passer 20 ans avec le même personnage ?
PF : Il était tout de même prévu d’adapter intégralement les romans originaux de Jean Van Hamme, car Largo Winch, à l’origine, c’est une série de 6 romans. Or, 6 romans = 12 bande dessinées, en sachant que Jean allait refondre chaque roman en deux tomes. Je m’attendais donc à y consacrer une bonne dizaine d’années. Et Jean m’avait laissé sous-entendre qu’il continuerait l’adaptation des romans avec des histoires originales… Je ne savais pas encore à cette époque que ce serait sans doute l’unique série de ma vie… Maintenant je le sais.
Comment vis-tu ça ?
PF : Ça se vit très bien. Je n’ai pas l’habitude de me disperser. Quand je tape sur un clou, je continue jusqu’à ce qu’il soit enfoncé. Largo est une série trop intéressante pour être négligée. Non pas parce qu’elle génère de l’argent, même si ça aussi, ça compte, mais par sa diversité, son potentiel inépuisable. L’actualité financière de la planète nous le prouve encore aujourd’hui. C’est du contemporain, donc au fur et à mesure, je m’adapte à l’époque. Si dans 20 je vis encore et que je suis amené à dessiner les histoires suivantes, probablement que les choses auront encore beaucoup changé autour de nous. De ce côté-là, ça n’est pas monotone. La structure même d’une histoire de Largo fonctionne un peu comme un James Bond : on est amenés à voyager aux 4 coins de la planète avec des décors et des contextes bien différents, qui ne durent jamais plus de 4-5 pages, c’est un atout qui empêche toute lassitude. J’ai intérêt à avoir une série longue et importante, ça me permet de jouer avec des personnages récurrents, qu’on a toujours plaisir à retrouver après quelques albums. Les anciens personnages réapparaissent toujours avec une dimension psychologique qu’on n’a pas avec les nouveaux personnages. La vie d’un personnage de papier est quelque chose qui demande du temps : il faut commencer à le voir parler pour qu’il prenne une dimension psychologique. La galerie de personnage est le propre et l’atout des séries au long cours.
Passer toute sa vie avec un seul et même personnage, en marge du succès que ça représente, cela ne fait-il pas un peu peur ? C’est un engagement important, non ?
PF : La plupart des auteurs ont l’impression d’évoluer dans leur métier parce qu’ils changent de séries. C’est une manière d’absorber de l’air frais, de ne pas s’asphyxier dans un train-train. Après 25 ou 30 ans, quand on regarde en arrière, on a l’impression de ne pas avoir fait grand-chose. Certains auteurs ont besoin de travailler sur d’autres choses pour se renouveler, pour continuer à avancer dans le métier. Moi, je pense que c’est un faux problème, qu’il y a moyen de se renouveler sans avoir besoin de passer à autre chose. C’est un peu comme dans un mariage ! On dit souvent que le plus dur est de passer le cap des 7 ans de vie commune. Après 7 ans, ça passe ou ça casse. C’est dans ce rapport là que je me trouve avec Largo : j’essaie en permanence de le regarder avec des yeux nouveaux. Régulièrement, j’essaie d’oublier tout ce que j’ai fait et je reprends le nouvel album avec un regard neuf, pour me motiver. En fait, dès le début, j’ai du aborder cette série avec un autre regard. Quand je suis arrivé dans la BD, j’avais envie de dessiner des aventures dans de larges espaces, dans la jungle, le désert, je ne me voyais pas du tout dessiner des villes. Lors de ma première entrevue avec Van Hamme, il m’a tout de suite mis au parfum, en me disant : t’es gentil, mais l’aventure telle que tu la conçois, c’est l’aventure des années 50 ; l’aventure moderne, elle, commence dans les villes. J’ai du faire un effort avec Largo, parce que d’emblée, j’ai du dessiner New York. Il a donc fallu que je me fasse violence pour être dans le bon état d’esprit psychologique. Jusqu’à cette collaboration avec Jean, pour moi, l’esthétique passait par les plantes. Je revenais toujours à la campagne pour pouvoir embellir les villes, avec des plantes d’appartement, des parcs… Je trouvais que l’architecture, la circulation, les voitures, les publicités urbaines, n’étaient pas suffisamment esthétisants, intéressants. C’est à force de les dessiner que je me suis découvert une manière de faire, esthétique, sans en passer systématiquement par la végétation, le saule pleureur, la petite rivière, les petits nénuphars et le héron qui pèche des poissons au milieu de tout ça. Résultat : je mets de moins en moins de parcs dans mes décors.
Tu travailles vraiment intensément l’harmonie et l’équilibre des dessins, personnages, décors, bulles, et le parcours de l’œil au sein de tes planches... Tu expliques ça avec moult schémas dans les albums making-of de ce 8e diptyque, et ça transparait d’une exigence graphique inouïe !
PF : Ces planches sont en fait des modèles du genre. Ça ne marche pas toujours aussi bien dans la réalité… Je suis quand même contraint à respecter une histoire, avec un certain nombre de plans nécessaires dont je ne peux pas m’affranchir. Dans la mesure du possible, c’est vrai que j’essaie de respecter cette exigence, mais ça se fait de manière naturelle. Ce making-of est une volonté de ma part de montrer quelque chose qui se fait de manière instinctive dans mon atelier. J’ai essayé de cassé le silence de l’atelier, de mettre des mots là-dessus. C’est l’œil qui juge, or l’œil ne parle pas. Je me suis surpris moi-même, d’ailleurs, du résultat assez pédagogique de l’exercice ! Heureusement que le lecteur ne s’en rend pas compte, parce que ce serait terrible. J’essaie de piéger le lecteur dans un jeu de piste à chaque fois répété, composé de texte, puis de dessin. Il faut que dès la première lecture, l’image soit limpide comme de l’eau de source. Il ne peut y avoir à aucun moment de doute pour le lecteur, ni d’identification des personnages, ni du lieu, que les choses soient toujours évidentes, que la lecture soit fluide. Et ce travail se fait de manière spontanée, à l’aide des textes, de la composition de l’image en elle-même, des masses claires et noires et au final, la couleur qui vient resserrer tout cela. La couleur permet de venir encore de recentrer avec des zones claires et sombres, des images qui sont parfois hyper fouillées.
Et justement, quelle relation entretiens-tu avec ton ou tes coloristes ?
PF : J’ai une manière de voir la couleur assez « propre ». Quand Fred Besson a commencé à travailler sur Largo, sur Les trois yeux des gardiens du Tao, je lui ai donné des directives très pointues. Fred travaillait à l’ordinateur et je voulais travailler via informatique. Avant, j’ai travaillé pendant 11 ans avec Marie-Paule Alluard, mais sans progrès significatifs au niveau de la couleur. Il a fallu passer à l’ordi pour avoir enfin la couleur que je désirais sur les albums.
Tu as l’air d’être hyper exigeant en la matière ?
PF : Oui, parce que la couleur, c’est quand même la première chose qu’on voit, en même temps que le trait. Et encore, le trait, il faut faire un effort pour le lire, tandis que la couleur, on se laisse pénétrer, envahir. C’est la couleur qui charme, qui fascine d’emblée. Pour moi, c’est la chose la plus importante. De pouvoir enfin maîtriser cet aspect, c’est le bonheur ! L’avantage de l’informatique, c’est qu’on peut toujours changer une teinte, un pourcentage, un calque… tandis qu’un papier gouaché, ça a des limites très vite atteintes. Il y a un moment où il est saturé : on ne peut plus revenir en arrière, ou on ne peut plus en rajouter. Ou alors on change de papier. Grace au numérique, on peut s’envoyer des planches avec Fred pendant plusieurs semaines, parfois ne pas trouver de solution, laisser reposer et affiner au fur et à mesure, faire évoluer jusqu’à un rendu qui nous semble parfait. Je garde toujours une copie du premier jet. Ça me permet de voir où on en était au début et où on en arrive à la fin. Et souvent, ça n’a rien à voir. Notamment les vues de Hong-Kong dans ce diptyque, on se les est envoyées tour à tour pendant au moins 3 semaines, plan par plan : le premier, le moyen, le lointain et tous les intermédiaires… ce type de plan est très compliqué à rendre agréable. Et quand on compare le résultat avec la première version de Fred, on avait l’impression qu’il n’y avait que 3 couleurs ! A force de travail, on a réussi à y introduire une richesse qui n’apparaissait pas initialement. Et pourtant, il est difficile de l’évoquer avec des mots : la couleur est quelque chose de terriblement ardu à formuler à l’aide du vocabulaire. L’autre avantage du numérique, c’est qu’on peut s’envoyer des fichiers décomposés par Internet, visuellement parlants, parce qu’évoquant un seul détail ou un aspect particulier de la couleur, et le revoir dans la minute intégré à l’ensemble. Tandis qu’à la gouache, c’était soit moi qui avais les planches chez moi et j’en parlais à Marie-Paule, soit Marie-Paule qui les avait et elle m’en parlait au téléphone, mais on n’avait pas cette base comunce de qualification.
As-tu un regard critique sur tes premiers albums ? As-tu l’impression d’avoir évolué ?
PF : Oui ! Je trouve avec le recul que mes premiers bouquins sont passablement ratés. On va s’occuper de rééditions à partir des années qui viennent. J’ai demandé à Fred de tout reprendre à rebours, à partir du tome 16, jusqu’au premier, pour tout recolorer par informatique. Pas pour faire une couleur très différente, mais plus nette, plus lisible, plus propre. Et magnifier partout où on avait merdé à la gouache.
Oui, mais quid des retouches sur les traits et les encrages ?
PF : Non, ça, je n’y retoucherais pas. J’accepte mieux mes merdages de traits que mes merdages de couleurs.
Tu as un album préféré de Largo Winch ?
PF : L’un de mes diptyques préférés, c’est certainement Voir Venise… et mourir. D’une part parce que j’aime la ville de Venise, mais aussi, il n’y a pas beaucoup d’histoires de Largo avec une course poursuite très prenante. L’autre dans le même genre, c’est Business Blues. Ce genre de trame haletante, c’est excitant aussi à dessiner.
Jean a lâché XIII, il a lâché Thorgal… mais il garde Largo Winch ! Tu te sens privilégié ?
PF : Et il garde aussi Lady S ! Largo et Lady S sont ses deux plus jeunes séries, en fait. Donc il y a une certaine logique à ce qu’il ait encore des idées à développer… Il le dit lui-même : sur Thorgal, il a le sentiment d’avoir fait le tour de la question, il était un peu « sec », il ne trouvait plus d’intrigues suffisamment intéressantes pour pouvoir continuer, donc il a passé le relais. En plus, la période du milieu du moyen-âge est assez compliquée à scénariser, c’est assez limité : pas de téléphone, pas de fax, pas d’internet… L’information à cette époque c’est quelque chose de très pénible : il faut prendre un bateau, un cheval ou la transporter à pied. Ce manque de modernité est un problème pour un scénariste. Ça ferme la porte à tout un tas d’intrigues. Quand à XIII, c’était une série, ou plutôt une saga qui était destinée à s’arrêter. Initialement, ça devait même s’arrêter à la découverte du « numéro 1 ».
Jean t’a-t-il annoncé qu’il arrêterait un jour, à un tome précis ou à un « niveau » déterminé ?
PF : Non. Tant que je prends plaisir à le séduire et réciproquement, c’est un dialogue de continuité. Le jour où je ne l’intéresserai plus par la manière dont je travaille ses scénarios graphiquement, si cette lassitude commençait à s’installer chez lui, il aurait peut-être envie d’arrêter la série. Tant que je pourrai l’étonner, je pense qu’il aura envie de continuer à raconter des histoires. En plus, là, avec la sortie du film, il est remonté à bloc !
Tu nous parles du tome 17 ? On peut avoir un scoop ?
PF : J’ai déjà réalisé les 7 premières pages d’introduction. Tout ce que je puis dire, c’est que ça se passe à des endroits que le lecteur connait déjà. Sans trop en dévoiler, on va dire que ça se passe dans la marine marchande. Mais je n’ai pas une vue d’ensemble du diptyque.
Comment Jean Van Hamme travaille t-il avec toi : tu reçois le scénario petit à petit ?
PF : Non, je reçois les 46 planches d’un coup. A la fin du tome 17, j’ai une idée sur la suite du tome 18, mais je n’ai pas de certitude. Il lui est même arrivé d’écrire les deux scénarios d’un coup. C’est rassurant d’un côté, mais c’est aussi un peu flippant de se dire que ces deux fois 46 planches dactylographiées vont t’occuper durant près de 3 ans. 3 ans de ta vie reposent là, en 90 pages.
Tu te permets des commentaires, tu as un droit de regard sur l’histoire qu’il t’envoie ? Comment se passe la collaboration ?
PF : D’une manière intelligente ! Jean est toujours ouvert à la discussion et moi aussi… Si l’un de nous deux déconne sur le moindre truc, l’autre n’hésite pas à le dire. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! On travaille tous les deux pour le bien de l’histoire, pour avoir la meilleure histoire possible, avec la meilleure efficacité possible. On ne se met jamais des bâtons dans les roues pour parvenir à cet objectif.
Il y a une émulsion particulière quand vous partez, par exemple, en repérage à Hong-Kong, comme ce fut le cas pour ce diptyque ?
PF : Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Tout en se tenant évidemment au courant, on travaille tous les deux d’une manière assez autonome. Jean ne sait pas ce que je vais faire de son scénario. C’est là qu’il y a ce rapport de séduction : j’essaie toujours de le surprendre en traduisant son scénario par des images qu’il n’a jamais vues auparavant. Mais je le fais aussi, évidement, en pensant au lecteur : il faut que je les scotche ! Moi, j’essaie encore de travailler ainsi. Je ne vais donc pas dire à Jean, lors d’un repérage, que je vais rendre les choses de telle ou telle façon. Je garde ce genre de chose pour moi, secrètement, pour le moment où je serai dans mon atelier. Une fois dans mon atelier, il faut que j’ai tout sous la main, tout ce que j’ai estimé, sur place, devoir immortaliser. A ce moment, je réalise des montages que je n’imaginais pas du tout en repérage. J’utilise les croquis, les photos et j’associe ensuite des images que je n’avais pas envisagé au départ. L’effet visuel arrive à ce moment là. Quand je suis dans la ville, c’est pour photographier un maximum de trucs qui me serviront par la suite pour la réalisation de l’album. J’ai renoncé à essayer de « voir » par avance tel ou tel plan. Sinon, on ne fait jamais ce qu’on a prévu de faire. Il faut surtout s’imprégner par l’ambiance de la ville et oublier ce qu’on va faire en atelier.
Il y a eu des moments difficiles dans le couple que tu formes avec Jean Van Hamme ?
PF : Non. On a exactement la même vision de ce que doit être une bande dessinée. C’est assez curieux d’ailleurs, cette association harmonieuse malgré la barrière générationnelle : Jean a l’âge de mon père et pourtant, on a la même vision des choses.
As-tu des envies de faire autre chose que Largo Winch ? Ou travailler avec d’autres auteurs ?
PF : Non. Si un jour je devais faire autre chose que Largo, ce serait pour travailler sur un sujet qui me changerait complètement du style d’histoire que je fais avec Jean. Ce serait une grande saga sentimentale, du type du Patient anglais, une histoire d’amour impossible à la Roméo et Juliette. Sur un 80 pages par exemple, avec un rythme radicalement différent… En fiction, les histoires d’amour qui finissent mal sont bien plus intéressantes que celles qui finissent bien, qui elles, n’ont aucun intérêt, sauf pour les gens dans la vie ! Ce sont celles qu’on retient.
En matière de BD, quelles sont tes inspirations, tes influences ?
PF : Tout. Mais plus particulièrement Hergé, Franquin et Hermann. Je relis encore aujourd’hui des Spirou et Fantasio, c’est d’une efficacité redoutable.
Et pas Astérix par exemple ?
PF : Astérix, c’est très intéressant, super bien découpé, super efficace, sinon ça n’aurait pas le succès que ça a eu… Mais j’ai toujours eu une préférence pour le dessin de Franquin, humoristique et néanmoins réaliste. Il suffit de regarder les expressions de Gaston ou de Fantasio, par exemple, ça n’est jamais surjoué, c’est toujours dans le bon ton de l’histoire. Et ce genre de chose, ça n’est même pas le cas dans Tintin. Spirou et Fantasio, c’est beaucoup plus vivant que Tintin, c’est ce que je connais de plus vivant pour l’époque. La vie sort des pages, réellement. Ensuite, Hermann, dans un autre style, c’est le gars qui m’a fait sentir qu’en bande dessinée, on pouvait rendre un effet cinématographique. Bernard Prince, c’est la première BD qui m’a fait oublier que je lisais un livre. Alors que pourtant, les couleurs dans Bernard Prince ne sont pourtant pas extraordinaire ! Je l’ai beaucoup copié, d’ailleurs. J’ai même cru pendant un temps qu’il ne pouvait plus me saquer à cause de ça. Et puis l’année passée, on est resté toute une après-midi ensemble et je me suis rendu compte qu’il ne m’en voulait pas du tout. Cependant, le talent d’un dessinateur n’est parfois pas suffisant pour faire marcher un album.
Tu lis beaucoup de BD encore aujourd’hui ?
PF : Je lis « certains trucs ». Lors du dernier festival d’Angoulême, je faisais partie du jury et j’ai donc reçu à ce titre quelques 56 bouquins. Dans le lot, il y a des choses qui me sont tombées des mains, tout de même… Mais bon, il faut de tout et n’importe quoi. En tant que jury, il faut que je sois subjectif. Il y a des choses que j’aime et d’autres que je n’aime pas et j’ai pour habitude de ne pas parler des choses que je n’aime pas…
Et qu’est-ce que tu aimes, par exemple ?
PF : (rires) J’adore Larcenet ! Son choix des images, son économie de moyens, ces situations à répétitions font que ça en devient hilarant, irrésistible. Quand je lis Larcenet, je me gondole ! C’est toujours une franche rigolade. Et pourtant, il n’y a pas grand-chose, quand je compare avec Gaston et la mise en scène nécessaire pour parvenir au résultat final, l’économie de moyens est inouïe !
Merci Philippe !